- Château de Lichtenberg
- Château de Babenhausen
- Château de Brumath
- Château de Darmstadt
- Château de Kranichstein
- Château de Philippsruhe à Hanau
- Château de Pirmasens
- Château de Woerth
- Château d’Ingwiller
- Hôtel de Hanau-Lichtenberg à Strasbourg

 Ces circuits ont été réalisés grâce au Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.
Ces circuits ont été réalisés grâce au Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.Château de Lichtenberg

Château de Babenhausen




Château de Brumath
Le clocheton, qui a été ajouté sur l’édifice afin de signifier la nouvelle destination du château, date de 1805.
La Société d’Histoire et d’Archéologie de Brumath (SHAB) a ouvert en 1971 un musée archéologique de la région de Brumath dans les sous-sols de l’église protestante.Rue Jacques Kablé, les anciennes dépendances du château, construites en 1720-26, sont conservées malgré leur division en plusieurs propriétés et la rupture de perspective entraînée par la création de la médiathèque.

Château de Darmstadt
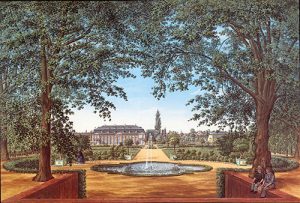

Château de Kranichstein

Château de Philippsruhe à Hanau

Château de Pirmasens

Château de Woerth

Château d’Ingwiller

Hôtel de Hanau-Lichtenberg
à Strasbourg

haut de page
![]()



